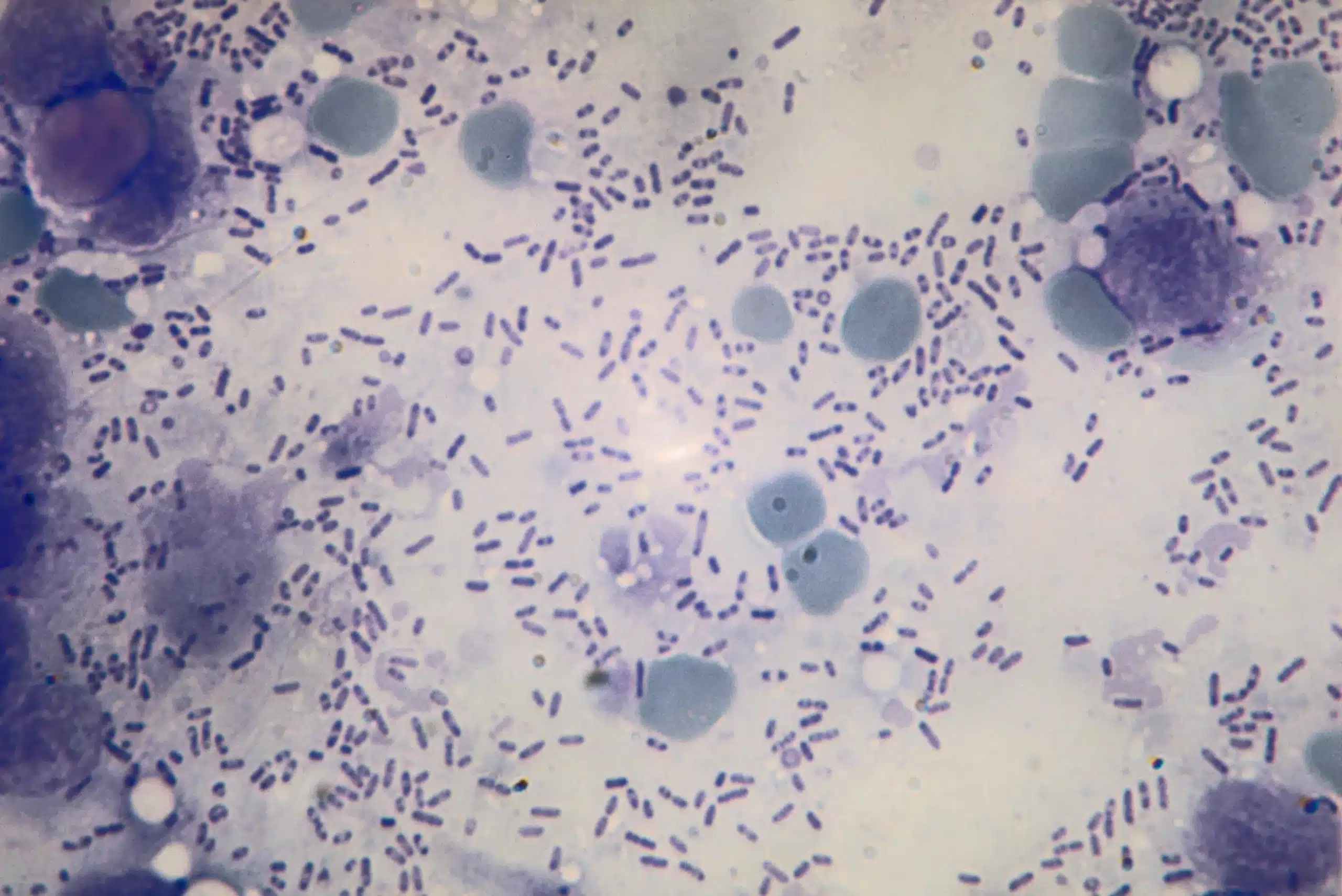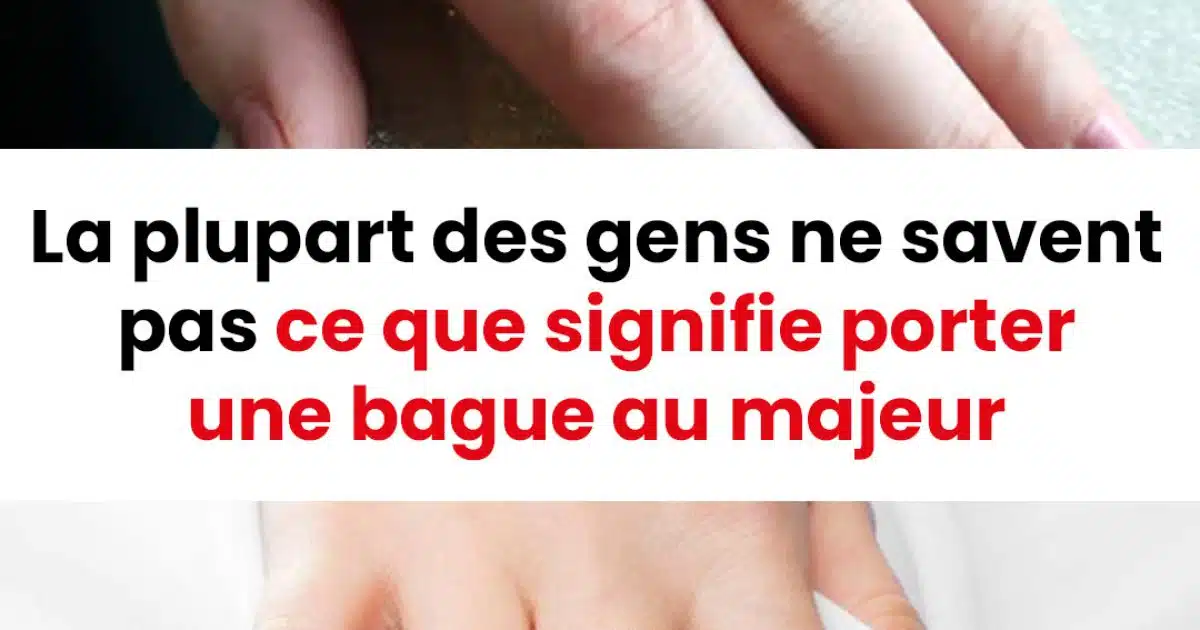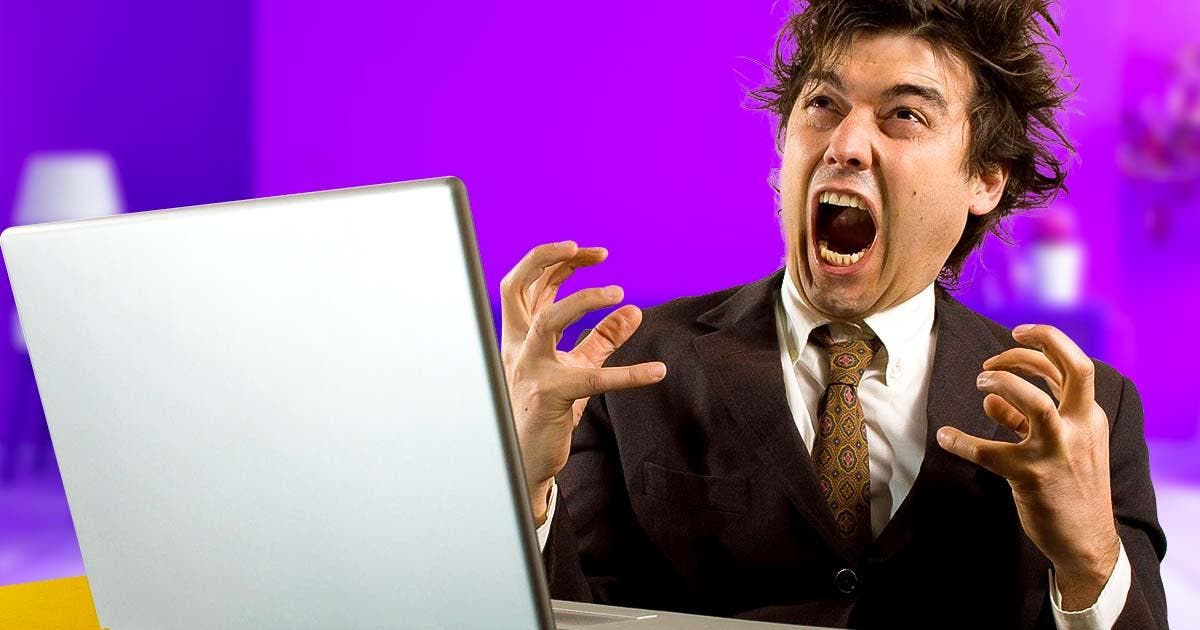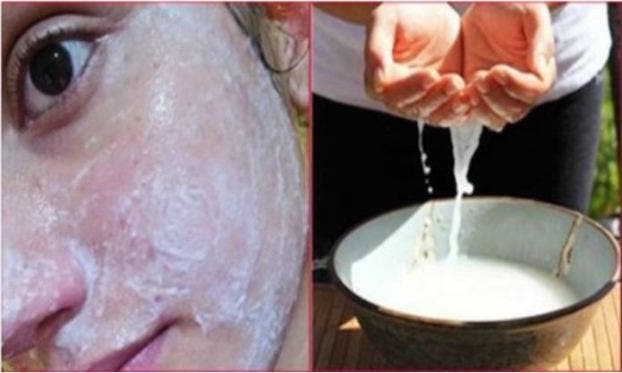Pourquoi l’année 536 a-t-elle été la pire année de l’humanité ?
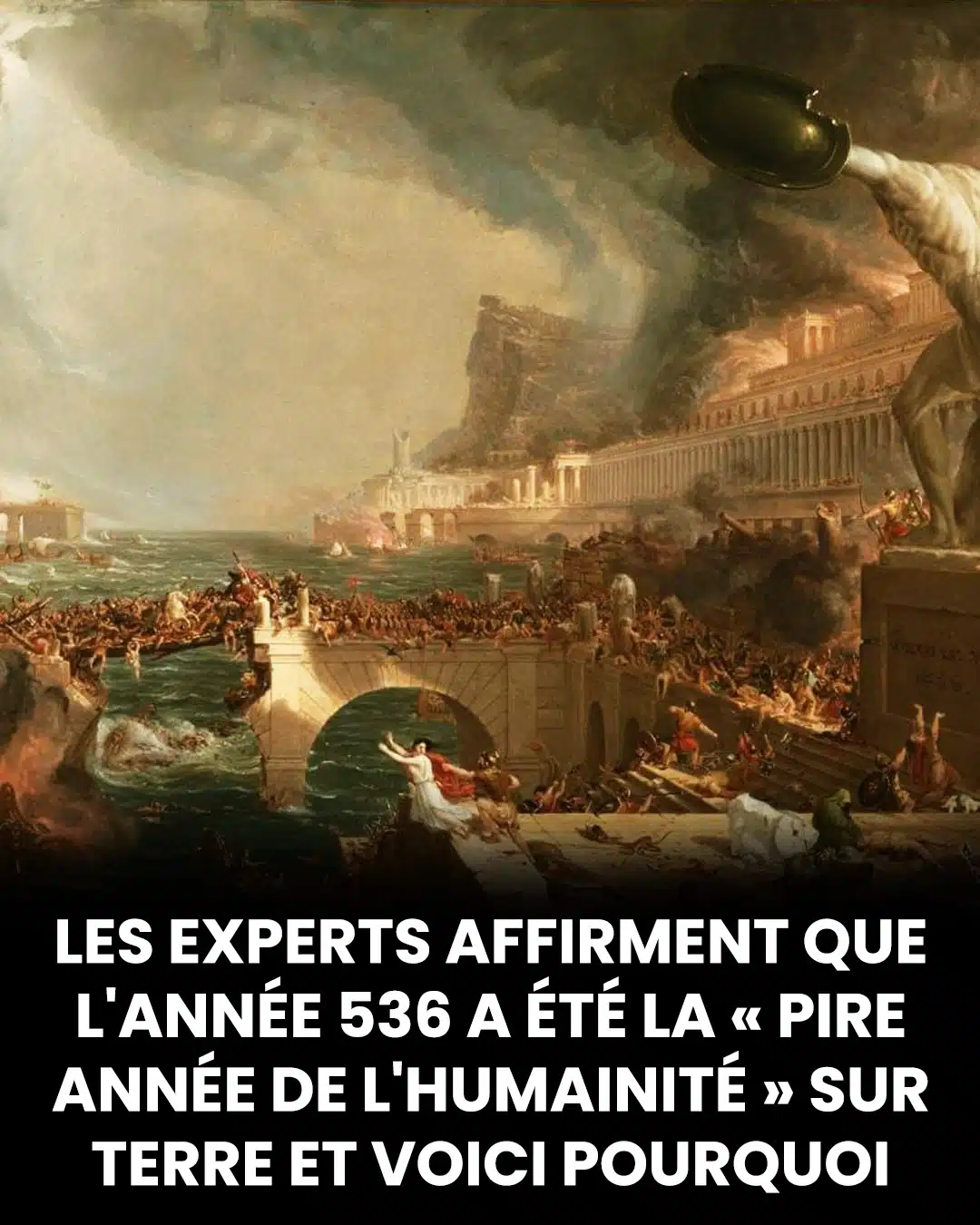
Imaginez un matin d'été où le soleil semble refuser de briller. Où la lumière du jour ressemble à celle d'une pleine lune voilée par une fine brume. C'est exactement ce qu'ont vécu les habitants d'une grande partie de la planète en 536 après J.-C., une année si dramatique que des médiévistes la considère aujourd'hui comme l'une des pires de l'histoire humaine. Mais que s’est-il donc passé pour que la Terre tout entière soit plongée dans un tel cauchemar ?
Un brouillard éternel : quand la lumière du jour s’est éteinte
Tout commence avec un phénomène aussi étrange qu’inquiétant. Pendant près de dix-huit mois, un mystérieux brouillard recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. L’historien byzantin Procope écrivait que le soleil brillait « sans éclat, comme la lune ». Résultat : une chute brutale des températures de 1,5 °C à 2,5 °C, un peu comme si notre climat méditerranéen se transformait soudainement en hiver nordique.
Les effets sont dramatiques : des chutes de neige en plein été en Chine, mauvaises récoltes, famines et désespoir sur plusieurs continents. En Irlande, les archives médiévales rapportent une pénurie alimentaire sévère entre 536 et 539. Comme un château de cartes, le fragile équilibre des sociétés humaines commence à vaciller.
La peste de Justinien : un coup de grâce brutal
À peine l’humanité commence-t-elle à reprendre son souffle que survient une autre tragédie : la peste bubonique, connue sous le nom de peste de Justinien, déferle en 541. Cette épidémie décime entre un quart et la moitié de la population de certaines régions, précipitant le déclin de l’Empire byzantin. Ce double coup du destin, famine puis pandémie, ancre durablement le VIᵉ siècle dans la mémoire comme une période de profond malheur.
À la recherche du coupable : des volcans entrent en scène

Molten lava is seen coming out of a fissure on the outskirts of the fishing village Grindavik in southwest Iceland, on April 1, 2025. The Icelandic Meteorological Office (IMO) said « an eruption has started on the Sundhnuksgigar Crater Row » north of the fishing village Grindavik that was evacuated Tuesday after lava began spewing from a volcanic eruption, the eighth to hit the region since the end of 2023. (Photo by Ael Kermarec / AFP)
Pendant des siècles, le mystère est resté entier : d’où venait ce brouillard mortel ? Grâce aux avancées de la science moderne, des chercheurs comme Michael McCormick et Paul Mayewski ont enfin percé le secret. En analysant une carotte de glace extraite d’un glacier suisse — véritable capsule temporelle de l’atmosphère —, ils découvrent que l’éruption d’un volcan en Islande a libéré d’énormes quantités de cendres dans l’atmosphère en 536.
Imaginez un volcan projetant un gigantesque nuage noir capable d’assombrir la lumière du jour sur toute l’Europe ! De plus, deux autres éruptions, survenues en 540 et 547, viennent aggraver la situation, plongeant l’économie dans une récession qui durera plus d’un siècle.
Une lente renaissance captée dans la glace
Tout n’est cependant pas sombre à jamais. Vers 640 après J.-C., les scientifiques détectent dans les carottes de glace une hausse des concentrations de plomb, signe que l’extraction d’argent — moteur du commerce et de l’industrie — reprend progressivement. C’est un peu comme voir les premières fleurs éclore après un hiver interminable.
Plus encore, vers 660, l’utilisation massive de l’argent comme monnaie témoigne d’une renaissance économique et de l’essor d’une classe marchande. Une sorte de « révolution économique » médiévale en miniature, surgissant des cendres d’une époque désolée.
Quand l’histoire se répète…
Mais la leçon n’a pas été apprise : au XIVᵉ siècle, lors de la Peste noire, la pollution au plomb chute brusquement, signe d’un nouvel effondrement économique. Comme le souffle d’un soufflet de forge qui s’éteint brutalement, l’activité humaine s’est de nouveau figée.
Grâce à ces recherches fascinantes, l’archéologie moderne révèle que nos sociétés demeurent extrêmement vulnérables aux forces naturelles. Et aujourd’hui encore, en observant les carottes de glace ou les cernes des arbres, la nature continue de nous raconter ses histoires oubliées.